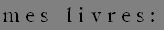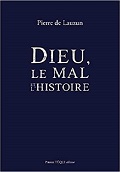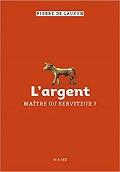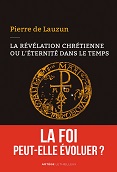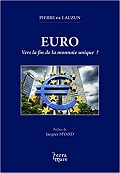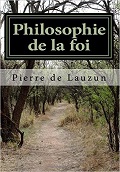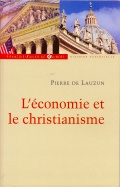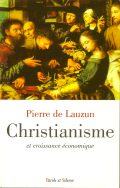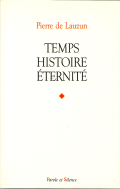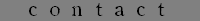
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
POLITIQUE
Articles de cette rubrique
-
Droitisation, vraiment ?
Publié le mardi 18 mai 2021
L’idée se répand qu’il y a une droitisation en Europe : une poussée de l’identification à la droite ou l’extrême droite politiques, et une plus grande approbation des idées dites « de droite ». C’est ce que nous indique Victor Delage dans La conversion des Européens aux valeurs de la droite. La masse des données convergentes qui y sont présentées est effectivement frappante. La question qui se pose est cependant plus complexe. Car ce que recouvre aussi bien l’identification à la droite politique, ou l’adhésion aux supposées « idées de droite », est loin d’être clair et univoque.
Suite…
-
Les ‘communs’ : mode, idéologie ou voie possible ?
Publié le mardi 13 avril 2021
Un thème a émergé récemment, les ‘communs’, populaire dans certains milieux, qui y voient une solution permettant d’échapper au marché et à l’Etat, à la suite des travaux d’E. Ostrom, prix Nobel. Mais l’idée est floue et hétérogène. Le sens de départ est proche de nos anciens biens communaux, et vise des ressources qu’une communauté humaine gère selon des règles collectives afin de préserver et pérenniser ces ressources limitées mais renouvelables.
Ce sens initial a été étendu à des catégories très différentes, prenant un tour idéologique affirmé, voire carrément révolutionnaire. Mais l’expérience a montré que le militantisme conduit essentiellement à l’étatisme. En fait, pour que l’idée de ‘communs’ ait du sens, il faut des mœurs, et une morale commune. Par un paradoxe apparent, ce thème aujourd’hui coqueluche de certains progressistes n’est fécond que dans le contexte du conservatisme et de la tradition classique.
Lire...
-
Indigénisme, pensée décoloniale, intersectionnalité : les nouveaux dilemmes du progressisme
Publié le lundi 5 avril 2021
Un fait trouble beaucoup le débat public : l’émergence récente de ce qu’on appelle indigénisme, décolonialisme, Black Lives Matter, sans parler des diverses théories du genre ou d’un certain féminisme, et des élucubrations de ce qu’on appelle intersectionnalité. C’est l’idée d’abord que des populations censément opprimées peuvent seules parler de ce qui est censé les opprimer ; et ensuite que l’ensemble de la culture et civilisation occidentale est coupable de ces oppressions, ce qui implique critique et épuration. Et on censure les auteurs, on abat les statues, on colonise médias et universités pour imposer le discours unique etc.
D’où le désarroi de l’opinion progressiste face à cette nouvelle gauche, par rapport à la vision universaliste (ou plutôt se voulant telle) qu’elle avait du progrès et de la société. Apparemment l’opposition est frontale. Mais en réalité tous deux sont issus d’une source commune, ou plutôt d’un paradigme fondateur.
Suite…
-
Que signifie être conservateur aujourd’hui ?
Publié le dimanche 17 janvier 2021
On parle beaucoup de conservatisme depuis quelques temps. C’est dû en partie à la situation politique : l’émergence d’Emmanuel Macron a fait éclater la cohabitation ambiguë des droites, libérale, conservatrice et autres, au sein des Républicains. Et on a perçu - un peu vite - les tentatives de F. Fillon ou de FX Bellamy comme signes de l’émergence de thèmes conservateurs. Mais c’est aussi un thème éditorial, comme le montre le monumental dictionnaire du conservatisme. Mon propos ici sera de cerner quel sens authentique, c’est-à-dire porteur de voies nouvelles, on peut lui donner aujourd’hui.
-
Les inégalités et la justice sociale (troisième article) : inégalités et participation à la société
Publié le dimanche 20 décembre 2020
Les inégalités sociales, la question obsessionnelle dans nos sociétés. Que devons-nous faire ? Qu’est-ce qui est un devoir moral, qu’est-ce qui est utopique ?
Je propose ici trois articles : un sur les inégalités de revenus, un sur les patrimoines, et un troisième sur ce qui est sans doute la vraie question : quelle est la participation de chacun à la société ?
Dans ce troisième article, deux idées de base. L’une, que la fameuse égalité des chances, outre qu’elle est partiellement utopique, ne résout pas la question : avoir perdu dans la compétition ne dit pas quelle est votre place dans la société, et le sens que celle-ci a pour vous. La deuxième, que la concentration du regard sur le besoin d’aider chacun à trouver sa place, reconnue, dans la société, est bien plus essentielle que l’égalitarisme, et peut conduire à réorienter de façon considérable les efforts collectifs pour aider chacun de nous, et notamment ceux qui en ont le plus besoin.
Suite …
-
Les inégalités et la justice sociale (deuxième article) : les inégalités de patrimoine
Publié le mercredi 16 décembre 2020
Les inégalités sociales, la question obsessionnelle dans nos sociétés. Que devons-nous faire ? Qu’est-ce qui est un devoir moral, qu’est-ce qui est utopique ?
Je propose ici trois articles : un sur les inégalités de revenus, un sur les patrimoines, et un troisième sur ce qui est sans doute la vraie question : quelle est la participation de chacun à la société ?
Ce deuxième article porte sur les inégalités de patrimoine, ou de fortune. Deux idées de base : une économie non totalement étatisée implique une propriété privée, laquelle ne peut être égalitaire. On peut certes avoir à réguler ces inégalités, mais vouloir les faire disparaitre est une utopie dévastatrice. Deuxième idée : il est essentiel de regarder les motivations et priorités des détenteurs de fortune ou de patrimoine, grands ou petits. On agira donc envers eux en tenant compte de ces motivations. Surtout à notre époque où leur culture esthétique et morale est pour dire le moins assez peu développée.
Plus que la seule inégalité, ce qui compte est donc la question de la participation des personnes à la société qu’un troisième article examinera.
Suite …
-
Les inégalités et la justice sociale (premier article) : les inégalités de revenu
Publié le samedi 12 décembre 2020
Les inégalités sociales, la question obsessionnelle dans nos sociétés. A la fois justifiée, et complétement faussée. Inégalité il y a, et pauvreté. Mais en même temps reste la question : que devons-nous faire ? Qu’est-ce qui est un devoir moral, qu’est-ce qui est utopique ?
Je propose ici trois articles : un sur les inégalités de revenus, un sur les patrimoines, et un troisième sur ce qui est sans doute la vraie question : quelle est la participation de chacun à la société ?
Premier article : sur les inégalités de revenus (et sur la pauvreté). Deux idées de base : la question de la pauvreté et celle des inégalités sont très différentes et doivent être distinguées. L’une concerne une fraction limitée mais prioritaire de la société, l’autre l’ensemble des rapports au sein de celle-ci. Deuxième idée : la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Justice commutative des échanges, et justice distributive dans la société. Tous nous avons des droits ; mais tous ne contribuent pas également. Une perspective qui n’est donc ni égalitaire, ni satisfaite des abus. Qu’un grand patron gagne beaucoup plus que moi est normal. Qu’il perçoive un revenu princier alors que sa gestion est médiocre ou nocive , en outre sans être tenu responsable sur ses deniers, est scandaleux.
Suite …
-
Géopolitique, morale et guerre juste
Publié le lundi 9 novembre 2020
Peut-on encore parler de guerre juste ? Ou toute idée de guerre serait d’emblée moralement exclue, ce qui conduit à faire complétement sortir la guerre de tout examen en termes moraux ? Même l’Eglise, traditionnellement prudente, est tentée par l’approche dite idéaliste.
Mais au vu de la réalité des rapports mondiaux entre pouvoirs, comportant indéniablement des guerres, est-il vraiment légitime d’écarter tout problématique de guerre juste ?
Lire…
Paru sur le site de Géopragma, le 9 novembre 2020.
-
Loi naturelle, Valeurs universelles et diversité des cultures
Publié le dimanche 27 septembre 2020
Droits de l’homme, démocratie : des valeurs universelles, vraiment ? Le constat est en réalité bien plus ambigu. Malgré les proclamations planétaires, ONU à l’appui. D’une part ces références sont remises en cause par bien des pays ou cultures, notamment en Asie ou dans le monde islamique. D’autre part, dans le monde occidental même elles subissent sans cesse des mutations profondes, alors même qu’elles sont supposées permanentes.
Se pose donc de façon renouvelée la question de la nature et du fondement de toute prétention à l’universalité de valeurs morales communes. La seule réponse rationnelle est la loi naturelle ; elle affirme l’existence de valeurs morales universelles, objectives, qui devraient s’imposer à tous par leur vérité même, et cela éventuellement en dehors de toute foi religieuse (même si l’Eglise catholique la défend). Mais c’est ce que le système dominant récuse. Ce qui le conduit à une forme de manichéisme. La loi naturelle au contraire est recherche d’universalité véritable.
Voyons ce que tout cela peut impliquer.
Suite...
-
Le soft power américain est toujours là… mais il mue
Publié le lundi 27 juillet 2020
La notion de soft power introduite par Joseph Nye a eu un succès immédiat. C’est une forme de pouvoir dans la vie internationale, non par usage de la force mais par persuasion et influence ; elle résulte de l’image que projette un État, mais aussi la société considérée, du fait de sa culture, de ses productions au sens large, de ses idées, etc.
Certains pensent qu’avec M. Trump le soft power américain est durablement altéré. Je pense au contraire qu’il mue mais reste prépondérant. L’influence du mouvement Black Lives Matter dans tout le monde occidental nous le confirme.
Suite
Publié sur le site de Géopragma
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET