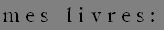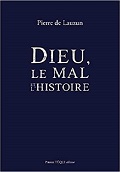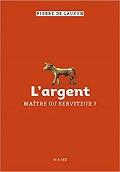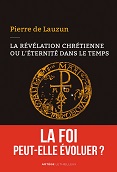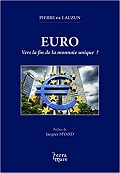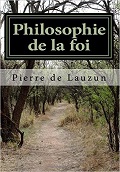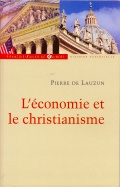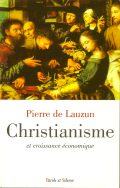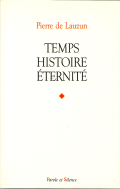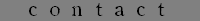
Derniers commentaires
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
- Un commentaire sur :
Sans titre
POLITIQUE
Articles de cette rubrique
-
La justice sociale dans un monde instable et évolutif
Publié le lundi 24 août 2015
Qui ne voudrait une vie collective et notamment une économie plus juste dans le monde d’aujourd’hui ?
Il faut pour cela bien sûr d’abord définir ce qu’est un ordre plus juste - ce que cela implique, notamment d’exigences éthiques et de solidarité. Cela remet d’ailleurs en question bien des idées reçues : la justice n’est pas toujours ce qu’on en dit.
Mais le défi le plus redoutable est ce monde d’aujourd’hui lui-même : hétérogène et instable, son évolution n’est pas contrôlée et peut aller dans tous les sens - alors même que les réglementations se font toujours plus pesantes.
Nous vivons en Europe dans l’illusion d’un destin stable et contrôlé ; or nous sommes dans un contexte de faible maîtrise de notre destin collectif. Et pourtant il faut quand même assurer une forme de solidarité, ainsi que le respect de justes règles de comportements – ils sont tous deux plus que jamais nécessaire. S’adapter à un tel environnement et y trouver les voies de la justice suppose donc de revoir en profondeur nos repères collectifs.
Suite…
Voir aussi : "Economie - finance : oui on peut changer les choses" Interview Ichtus avec G. de Prémare, en ligne le 17 octobre 2015 https://www.youtube.com/watch?v=J1B...
-
Communautarisme et immigration
Publié le mercredi 10 septembre 2014
On brandit le risque du communautarisme et on a raison. De fait dans nos pays toute une partie de la population ne s’identifie plus à la communauté nationale et privilégie ses références d’origine, quitte bien sûr à profiter des droits associés à la nationalité française.
Une telle situation n’est pas compatible à terme avec le maintien d’une communauté, et notamment en l’espèce avec un système démocratique, lequel suppose qu’on s’identifie au peuple qui vote et détermine la majorité. S’identifier suppose de former avec lui une communauté de destin - ce qui suppose à son tour un patrimoine de références commun et un engagement dans la communauté nationale. Ce n’est désormais plus un fait acquis, allant de soi.
Une telle situation est profondément nouvelle et demande une révision en profondeur de notre conception de la nationalité.
Suite…
-
Droit et crises internationales : les séductions de l’utopie
Publié le jeudi 7 août 2014
D’un point de vue moral ou même simplement humain, la situation internationale actuelle est consternante. Ukraine, Syrie, Iraq, Gaza, la liste des déconvenues et des horreurs face auxquelles on a un sentiment irrésistible d’impuissance, est bien longue.
Pour l’améliorer, un recours plus large au droit est-il la bonne réponse, comme beaucoup le pensent, avec les meilleures intentions du monde ? La réponse est malheureusement dubitative, ce qu’on appelle droit étant en la matière trop souvent soit incertain, soit manipulé idéologiquement.
Cela ne veut pas dire qu’il faut renoncer à la recherche de la paix ; mais cela veut dire la chercher autrement : non pas en tablant sur les ressources faciles mais contre-productives de l’idéologie, mais en prenant les situations pragmatiquement.
Suite...
-
Face à la crise, la communauté nationale
Publié le mardi 15 juillet 2014
Une nation est une communauté de destin. La solidarité qu’elle implique est un élément essentiel pour ses membres, dont elle est un horizon d’appartenance, de sens et aussi de sécurité essentiel.
Mais ce sens de la communauté de destin s’érode rapidement en Europe, et de façon particulièrement préoccupante en France, du moins au niveau public et visible. Notamment si on prend conscience de notre situation de crise larvée, appelée à de nouvelles secousses un jour ou l’autre compte tenu des déséquilibres du système mondial.
On ne fonde pas la solidité d’une société sur la seule économie, de toute façon trop fluctuante, trop vulnérable à la conjoncture. Ni sa capacité à résister aux crises. Il faut des références communes fondatrices, et notamment ce sentiment vécu d’une communauté de destin que donne la nation, ainsi que les communautés de base, à commencer par la famille.
Suite…
-
Pourquoi des manifs pour la vie ou le mariage, et pas sur du social ?
Publié le samedi 15 février 2014
Pourquoi des manifs pour la vie ou le mariage, et pas sur autre chose, du social par exemple ? Le reproche surgit régulièrement : vous faites des manifs sur les sujets de société comme le mariage ou la protection de la vie, l’avortement, l’euthanasie… mais pas du tout sur les sujets sociaux ou économiques, pourtant tout aussi importants – et sur lesquels insiste la Doctrine sociale de l’Eglise.
L’objection est sérieuse et mérite examen.
Suite...
-
Contre un régime immoral : la révolte ? La désobéissance ?
Publié le dimanche 26 janvier 2014
Nous comprenons chaque jour plus que nous vivons sous un régime politique capable de prendre des décisions destructrices : des décisions qui peuvent rendre la société de plus en plus contraire à la morale, la morale la plus élémentaire des sociétés humaines telles que nous les connaissons depuis des siècles, notamment dans les sociétés éclairées par le christianisme. Que faire alors ?
Chez certains le raisonnement est radical : le régime n’est plus moralement légitime, passons à l’action directe, pour le moins à la dissidence. Mais ce n’est pas la bonne approche. Outre ses faibles chances de succès, ce n’est pas la voie que recommande la pensée politique classique. Car il y a un bien essentiel dans le fait de la vie commune et dans la paix, et seules de très fortes raisons peuvent conduire à prendre le risque de les briser.
Suite...
-
Changer le débat politique, changer nos priorités collectives
Publié le vendredi 18 octobre 2013
Notre vie politique patine et devient chaque jour plus stérile. La solution à tous les dilemmes sociaux depuis 40 ans, c’était la croissance. Quand il y en a eu moins ce fut la fuite en avant de la dette publique, avec tous ses risques. Or maintenant cela ne marche plus : il y aura peu de croissance, et elle sera spontanément très inégale ; quant au crédit on a trop tiré sur la corde, c’est fini. Il faut donc manifestement changer d’orientation et proposer autre chose au peuple français. Et pour cela regarder la réalité en face.
Une des dimensions les plus stériles du débat actuel est l’opposition entre les partisans de la compétition et de la rigueur, qui sont comprises comme réduction massive de la solidarité, et les partisans d’une forme de moralité se voulant solidaire, comprise comme maintien ou renforcement du système social et étatique actuel. Cette opposition est stérile. En réalité il faut repenser ces deux termes pour les combiner autrement, et cela tant en termes d’efficacité que de vraie moralité. Pour cela je propose les points de repère suivants. Suite…
-
Canaliser la pensée collective : le filtre de l’idéologie dominante
Publié le mercredi 9 octobre 2013
Pourquoi les manifestations publiques qui vont contre la pensée dominante sont-elles si peu prises en compte ? Pourquoi les uns bénéficient de l’intérêt bienveillant des médias alors que d’autres sont suspects dès qu’ils ouvrent la bouche ? Pourquoi parle-t-on aussitôt de ’dérapage’ ?
Cela ne peut s’expliquer seulement par les tendances politiques des journalistes, ni par un supposé complot. Il s’agit de quelque chose de plus profond, qui va au-delà du politiquement correct : un mécanisme d’hégémonie sur la pensée, intériorisé par la plupart de ceux qui ont accès à la parole ou plutôt à son expression collective. C’est en fait une forme de régulation sociale non reconnue, et en l’espèce perverse.
Renverser une telle hégémonie n’est pas une mince affaire et demande un bouleversement profond, qui prend du temps.
Suite…
-
Vivons-nous aux dépens du futur ?
Publié le samedi 5 octobre 2013
Notre société est-elle fondamentalement prédatrice ? Plus précisément, vit-elle aux dépens des générations futures ? Plusieurs aspects de l’écologie comme de la finance nous le confirment. L’endettement de masse, surtout public, reportant le poids de pures consommations sur les générations qui suivent en est un cas évident. Comme dans son domaine la pollution - quand elle est cumulative.
Ce qui veut dire que nos sociétés, incapables de prendre leurs responsabilités et de prendre des décisions difficiles, reportent le poids de leurs conflits comme de leurs facilités sur des générations qui par construction n’ont pas voix au chapitre dans le débat politique. Une dérive qui date de 40 ans. Ce sont donc 40 ans d’habitudes et de mauvais principes à renverser.
Mais tout cela en même temps sans s’illusionner sur la possibilité d’une société sans risques : elle n’existe pas. Il nous faut donc combiner plus de morale, avec plus de courage…
Suite….
-
Le tourisme stratégique des Occidentaux au Moyen-Orient
Publié le vendredi 30 août 2013
L’explosion du débat sur la Syrie après l’attaque chimique de Damas confirme l’impression consternante que donne le monde occidental depuis le début du Printemps arabe : des apprentis sorciers, ignorants de la logique et des règles du jeu local, improvisent des prises de positions et des interventions armées par projection de leurs fantasmes et stéréotypes occidentaux, sans comprendre l’extraordinaire complexité et illisibilité d’une zone où depuis 4000 ans tout le monde peut être tour à tour allié et ennemi de tout le monde, où tout le monde ment, parce que tout le monde mène un jeu de pouvoir précaire et sans merci.
Suite...
... | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
Besoin de réaliser votre site internet ? - Conception & réalisation du site : WIFIGENIE.NET